
Qu'est-ce que la dignité de la personne humaine ?
La reconnaissance de la « dignité incomparable et inaliénable » (Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église §105) de toute personne humaine est le point de départ de la Pensée Sociale Chrétienne. Exprimée comme un principe, la dignité de l’homme est le socle sur lequel s’appuient les autres principes. Elle en est aussi le cœur qui lui donne sa force. En effet, l’affirmation de la reconnaissance du caractère sacré de toute personne conduit l’Église à affirmer que « loin d’être l’objet et comme un élément passif de la vie sociale », l’homme en est au contraire, et doit en être et demeurer le sujet, le fondement et la fin » (Compendium de la DSE §106).
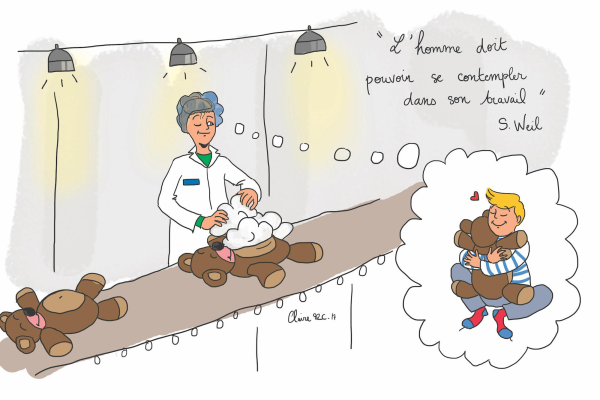
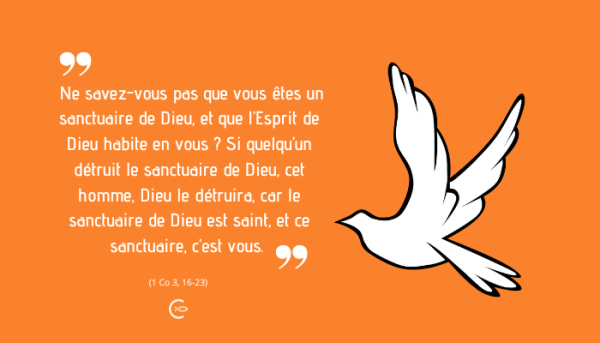
La dignité de la personne humaine se retrouve dans de nombreuses sagesses
La dignité de l’homme est largement présente dans la plupart des pensées, religions et sagesses humaines, y compris dans le code du travail français. Notamment dans l’article sur les droits des personnes et des libertés individuelles et collectives (Art L1121-1) et celui sur les conditions de travail et d’hébergement (Art L8112-1). Mais, si la dignité de l’homme est une idée universelle, ce que chacune des sagesses rattache à ce principe et la façon dont elle l’applique varient. Pour plonger dans la vision chrétienne de l’homme relisons la première épître aux Corinthiens. Saint Paul y place haut l’exigence : « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous ». (1 Co 3, 16-23)
Créé à l’image de Dieu, l’homme se voit confier une grande responsabilité envers tout ce qui l’entoure.
Et il est intéressant de faire le lien avec le travail dans la suite du récit de la Genèse 3, 17-19 : « Dieu dit enfin à l’homme : « C’est dans la peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C’est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu’à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens ; car tu es poussière et à la poussière tu retourneras ». La pénibilité du travail « à la sueur de ton visage » ne semble être due ici qu’au sol qui devient source de mauvaises plantes autant que de bonnes, et non à une malédiction contre l’homme.
Le « labeur » peut devenir « oeuvre »
Le « labeur » qu’est le travail d’après l’étymologie latine (labor) peut encore devenir « œuvre » ("opus", autre mot latin) selon la destination qu’on lui donne : selon qu’il est pour soi, simplement pour survivre matériellement, ou pour un but plus large, coopérer avec et pour d’autres. C’est une distinction importante reprise très clairement par Hanna Arendt dans "La condition de l’homme moderne" publié en 1958, qui décrit également sa liberté, vue comme « capacité d’introduire du nouveau ».
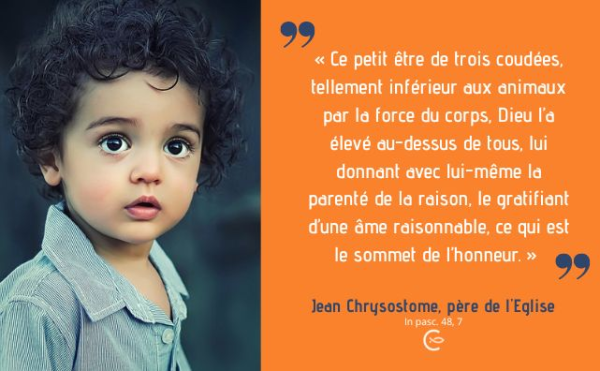
C’est respecter la dignité de chacun que de reconnaître ses limites pour ne pas le mettre en situation d’échec.
C’est respecter la dignité de chacun que de reconnaître ses limites pour ne pas le mettre en situation d’échec. Enfin qui dit dignité et liberté dit aussi participation et accès à des droits. L’accès aux droits relève du plan politique, mais il comporte un volet social auquel les entrepreneurs chrétiens sont nécessairement sensibles. Il s’agit de comprendre ces droits juridiques en fonction de leur objectif, qui doit toujours être orienté vers le bien des personnes, sans lequel le bien commun n’est qu’un concept vide. Ainsi de la liberté d’expression qui doit respecter celle des autres, de la liberté de conscience qui peut amener à discuter certaines pratiques, ou dans l’entreprise du dialogue social qui ne saurait être contourné, mais plutôt anticipé pour les Entrepreneurs et Dirigeants chrétiens.
De ce principe fondamental découle la liberté
Dans la pensée sociale chrétienne, la vision de la personne humaine, de la société ou de l’entreprise repose sur cette dignité fondamentale et inaliénable. Elle invite à reconnaître chaque personne comme une et unique. « L’Eglise voit dans l’homme, dans chaque homme, l’image vivante de Dieu lui-même ; image qui trouve et est appelée à retrouver toujours plus profondément sa pleine explication dans le mystère du Christ, Image parfaite de Dieu, Révélateur de Dieu à l’homme et de l’homme à lui-même » (source : Compendium de la DSE § 105). De sa dignité, découle la liberté de la personne. Celle-ci lui donne la capacité d’agir et d’orienter sa vie. La personne est ainsi un sujet capable de conscience et de liberté, qui ne saurait en conséquence être manipulé ou finalisé à un quelconque projet.
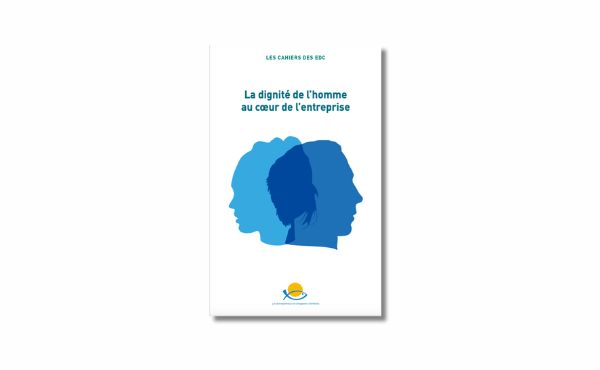
Rédigé par la commission Sources Bibliques et Théologiques des EDC, ce cahier fait partie d’une série sur les principes de la Pensée sociale chrétienne au sein des entreprises. La conception qu'a un dirigeant de ce qu’est l’homme guide son action et oriente peu à peu tout le fonctionnement de l’entreprise. Ce livret invite tous les dirigeants à se questionner sur leur conception : Est-elle vraie ? Est-elle juste ? Est-elle source de fécondité ? Est-elle partagée ? L’ambition de cette collection de cahiers sur la Pensée sociale chrétienne est de mettre à la disposition des membres du mouvement une réflexion de fond et une base de discussion. Elle complète et nourrit les autres actions proposées par le mouvement aux équipes sur la Pensée Sociale Chrétienne (Recueil de témoignages, parcours de formation, moments de ressourcement, rubriques du site, itinéraires en équipe etc.)

Le mouvement offre à tout nouveau membre l’opportunité de se former à la pensée sociale chrétienne appliquée au monde de l’entreprise, en format visio interactive. Ce cycle de formation se déroule en zoom, chaque lundis de juin en fin d’après-midi (de 18h à 20h).
Les sessions online se déroulent en septembre, janvier et juin de chaque année.
Quels liens entre le principe de dignité et les autres principes de la pensée sociale chrétienne ?
De la dignité, de l’unité et de l’égalité de toutes les personnes découle avant tout le principe du bien commun, auquel tout aspect de la vie sociale doit se référer pour trouver une plénitude de sens. (Compendium de la DSE § 164) "La personne ne peut pas trouver sa propre réalisation uniquement en elle-même, c’est-à-dire indépendamment de son être « avec » et « pour » les autres." Cette vérité lui impose non pas une simple vie en commun aux différents niveaux de la vie sociale et relationnelle, mais la recherche sans trêve du bien sous forme pratique et pas seulement idéale, c’est-à-dire du sens et de la vérité qui se trouvent dans les formes de vie sociale existantes. Une vision purement historique et matérialiste finirait par transformer le bien commun en simple bien-être socio-économique, privé de toute finalisation transcendante, c’est-à-dire de sa raison d’être la plus profonde. (Compendium § 165 et 170)
Lien avec la participation et la solidarité
« La participation est l’engagement volontaire et généreux de la personne dans les échanges sociaux. Il est nécessaire que tous participent, chacun selon la place qu’il occupe et le rôle qu’il joue, à promouvoir le bien commun. Ce devoir est inhérent à la dignité de la personne humaine ». (CEC n°1913) La solidarité confère un relief particulier à la socialité intrinsèque de la personne humaine, à l’égalité de tous en dignité, au cheminement commun des hommes et des peuples vers une unité toujours plus désirée. Jamais autant qu’aujourd’hui il n’a existé une conscience aussi diffuse du lien d’interdépendance entre les hommes et les peuples, qui se manifeste à tous les niveaux. (CEC §192)
La dignité et la destination universelle des biens
Ce principe se base sur le fait que « la première origine de tout bien est l’acte de Dieu lui-même qui a créé la terre et l’homme, et qui a donné la terre à l’homme pour qu’il la maîtrise par son travail et jouisse de ses fruits (cf. Gn 1, 28-29). Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu’elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne. C’est là l’origine de la destination universelle des biens de la terre. En raison de sa fécondité même et de ses possibilités de satisfaire les besoins de l’homme, la terre est le premier don de Dieu pour la subsistance humaine ». (CEC § 171)
Lien entre dignité et subsidiarité
« De même qu’on ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s’acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice, en même temps que troubler d’une manière très dommageable l’ordre social, que de retirer aux groupements d’ordre inférieur, pour les confier à une collectivité plus vaste et d’un rang plus élevé, les fonctions qu’ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. L’objet naturel de toute intervention en matière sociale est d’aider les membres du corps social, et non pas de les détruire ni de les absorber ». (Pie XI, Encycl. Quadragesimo anno)


