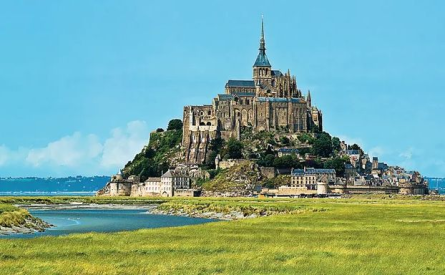Être Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
Les Entrepreneurs et Dirigeants cherchent une unité intérieure dans leur existence de décideur et de chrétien. Les EDC les accompagnent sur leur chemin de foi, leurs questionnements, leur progression. Notre mouvement les aide à décider et à agir en chrétien dans leurs entreprises : devenir un entrepreneur et dirigeant chrétien qui promeut l’économie du bien commun en s’appuyant sur la pensée sociale chrétienne.
Pourquoi devenir membre ?
Le mouvement des EDC propose à ses membres un véritable accompagnement et une équipe fraternelle où partager ce qu’ils vivent : prier ensemble et mieux répondre aux questions que chacun se pose, approfondir un thème. Participer à des formations, des événements, accéder à des ressources pour progresser ensemble dans l’exercice de ses responsabilités.
Les responsabilités
Le mouvement des EDC est animé par quelque 400 membres engagés bénévolement dans diverses responsabilités. Prendre des responsabilités dans le mouvement est un formidable moyen de progresser, dans un esprit de fraternité et de service.
Découvrir les EDC
Découvrez les Entrepreneurs & Dirigeants Chrétiens !
Nous sommes un mouvement de plus de 3 700 entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui cherchent à aligner leur vie de foi et leur vocation de leader. Nous nous appuyons sur la pensée sociale chrétienne,...
Tous réunis du 15 au 17 mars 2024 !
Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens se remettent en question comme jamais, après 3 années de profondes mutations. Comment ré-enchanter le travail dans nos entreprises et redécouvrir le sens...
Les membres EDC témoignent
Actualités
Agenda
Les EDC dans les régions
La revue des Dirigeants Chrétiens
La Fondation
Elle conduit, soutient et promeut des actions sociales et philanthropiques d’intérêt général qui ordonnent la vie économique autour de l’homme et du bien commun.
Inspiré par la pensée sociale chrétienne, son engagement suit trois objectifs :
1. Diffuser la culture de l’économie du bien commun auprès des dirigeants
2. Former des jeunes professionnels autonomes et responsables
3. Créer de l’emploi pour les plus fragiles.
Les projets associatifs qu’elle sélectionne et finance sont mis en œuvre en France.